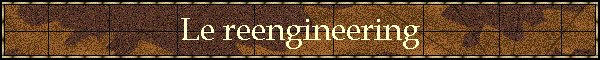
|
|
|
Antony
COUNET DESS
CONTRÔLE DE GESTION MICHAEL HAMMER - JAMES CHAMPY
LE
REENGINEERING Réinventer l’entreprisepour
une amélioration spectaculaire de
ses performances DUNOD 1993
Introduction. L’ouvrage
dont nous allons effectuer la synthèse remet en cause toute la pensée
traditionnelle sur l’entreprise. Son intérêt réside sur son fondement
empirique. Combattre la crise actuelle afin de la vaincre n’est plus une
utopie théorique, mais bel et bien une réalité. Peu nombreuses sont les
entreprises à y être parvenues, mais leur réussite, décodée et analysée
par les auteurs, vaut la découverte de ce livre... 1.
La crise actuelle peut être résolue grâce au reegineering. 1.1.
Cette crise qui semble insoluble. La
récession actuelle qui touche un grand nombre d’entreprises n’est pas
seulement conjoncturelle. Elle masque une crise structurelle bien plus grave. Le
monde dans lequel les entreprises fonctionnent a changé au-delà de ce
qu’autorisait leur capacité d’ajustement ou d’évolution. Pour
retrouver leurs capacités concurrentielles, les sociétés doivent non pas
amener leur salariés à travailler davantage mais à travailler autrement. La
plupart des entreprises d’aujourd’hui travaillent autour de l’idée d’Adam
Smith développée dans « La richesse des nations » : la
division ou la spécialisation de la main d’œuvre et la fragmentation du
travail qui en découle. Les salariés ne font jamais le travail en entier ;
ils se contentent d’accomplir des tâches parcellaires. Le
système de pouvoir hiérarchique en vigueur dans la plupart des entreprises
contemporaines applique les mêmes principes que les compagnies de chemin de fer
voici cent cinquante ans. L’administration d’entreprise consiste
essentiellement à programmer les gens pour qu’ils se conforment aux procédures
établies. La
division du travail intellectuel, parallèle à celle du travail manuel,
subsiste aujourd’hui ; on la doit essentiellement à Alfred Sloan
chez General Motors au début du siècle. Les cadres du siège n’ont pas
besoin de compétences particulières en production. Ils se contentent
d’examiner des chiffres. Subsiste
aujourd’hui le management issu des Etats-Unis entre la fin de la seconde
guerre mondiale et les années 60, période de forte expansion économique. Grâce
à de savants travaux de planification, les cadres supérieurs déterminent les
métiers que leur entreprise devrait exercer, la quantité de capitaux qu’il
faudrait consacrer à chacun d’eux et la rentabilité réclamée par la société
mère aux responsables opérationnels des différentes activités. Le
problème est qu’aujourd’hui, on ne peut plus compter sur un cycle économique
prévisible - prospérité puis récession suivie d’une prospérité retrouvée.
Trois forces, « les trois C », agissant à la fois
ensemble et séparément, poussent les entreprises de plus en plus loin sur un
terrain inconnu qui inquiètent la plupart de leurs cadres et dirigeants :
ce sont les Clients, la Concurrence et le Changement. • Les clients prennent le pouvoir. Le
marché de masse s’est brisé ; le client a le choix. Chaque
client - consommateur ou entreprise - demande à être traité individuellement.
Il attend des produits adaptés à ses besoins, des délais de livraison adaptés
à ses projets industriels ou à ses heures de travail et des conditions de
paiement adaptées à ses moyens. En
bref, au lieu des marchés de masse en expansion des années 50, 60, et 70, les
entreprises ont en face d’elles des clients - entreprises ou particuliers -
qui savent ce qu’ils veulent, ce qu’ils sont prêts à payer et comment
l’obtenir dans les conditions de leur choix. Ils ne sont nullement obligés
d’en passer par les sociétés qui n’auraient pas compris et assimilé cette
mutation radicale de la relation client-acheteur. Le
pouvoir économique est passé du producteur au consommateur.
A
cela nous pouvons énumérer plusieurs facteurs : La
production de masse « plus » - plus la qualité, plus le prix, plus
le choix et le service - mise en place par la concurrence japonaise a emballé
l’attente du consommateur. Dans
le secteur des services, les consommateurs attendent et exigent davantage parce
qu’ils savent obtenir davantage. Les bases de données sophistiquées
permettent aux fournisseurs de services de connaître les préférences et les
exigences des clients, ce qui jette les fondements d’une nouvelle compétitivité. La
menace d’une intégration « à rebours » a aussi contribué à
faire passer le pouvoir des producteurs à celles de leurs clients. Avec la
Publicité Assistée par Ordinateur, par exemple, les entreprises peuvent fort
bien faire elles-mêmes des travaux qu’elles avaient l’habitude de confier
à des imprimeurs. La
position du vendeur est fragilisée car l’acheteur potentiel a accès à
nombres d’informations sur tout ce qui est proposé sur le marché. Aujourd’hui
chaque client compte. Si l’on perd un
client aujourd’hui, il n’y en a pas d’autre pour le remplacer. • La concurrence se durcit. Aujourd’hui
la concurrence n’est pas seulement plus nombreuse, elle est aussi multiforme. Avec
la libération des échanges, aucun territoire national n’est à l’abris de
la concurrence. Un
seul acteur meilleur que les autres est capable d’élever le seuil
concurrentiel pour toutes les entreprises du monde. Toute
entreprise installée doit aujourd’hui garder un œil sur les nouvelles
entreprises. Les
nouvelles entreprises ne respectent pas les règles. Elles en édictent de
nouvelles. • Le changement devient incessant. Le
changement est devenu constant et omniprésent. Il est la normalité. De
plus, le rythme du changement s’est accéléré. Le cycle de vie des produits
et services a donc diminué mais aussi le délai disponible pour en développer
et en lancer de nouveaux Les
entreprises doivent exercer une surveillance tous azimuts pour détecter
efficacement le changement, mais tel est rarement le cas. Les
changements susceptibles de tuer une entreprise sont ceux auxquels elle ne
s’attend pas ; or c’est le cas de la plupart des changements dans
l’environnement économique actuel. 1.2.
Reengineering - Le chemin du changement. Le
message central de ce livre est le suivant : dans le monde actuel, les
emplois voués à une tâche sont dépassés. Il faut rejeter les hypothèses
inhérentes au paradigme industriel d’Adam Smith : la division du
travail, les économies d’échelle, le contrôle hiérarchique et tous les
autres accessoires d’un économie aux premiers stades de son développement. Les
entreprises doivent organiser leur travail autour de processus opérationnels
transversaux. C’est l’objet du reengineering. Ainsi
nous pouvons définir dès maintenant en quoi consiste le reengineering :
c’est une « remise en cause
fondamentale et une redéfinition radicale des processus opérationnels pour
obtenir des gains spectaculaires dans les performances critiques que constituent
aujourd’hui les coûts, la qualité, le service et la rapidité. » Définissons
également un processus opérationnel : c’est une suite d’activités
qui à partir d’une ou plusieurs entrées (inputs) produit un résultat
(output) représentant une valeur pour le client. Par
exemple, dans le traitement des commandes dans une entreprise, c’est la
livraison au client des biens demandés qui constitue la valeur créée par le
processus. Les
tâches individuelles participant au processus (la réception du bon de
commande, la facturation ...) sont importantes, mais aucune d’elles ne vaut
quoi que ce soit aux yeux du client si le processus dans son ensemble ne
fonctionne pas - c’est-à-dire s’il n’aboutit pas à la livraison de
marchandises. Aujourd’hui
personne n’est responsable des processus. Beaucoup y travaillent, mais il
n’y a jamais de véritable responsable. Par exemple il existe très rarement
un responsable du développement de nouveaux produits. Les
problèmes d’efficacité des entreprises contemporaine trouvent leur source
dans la fragmentation des processus opérationnels. Dans
bien des entreprises, le coût de la main d’œuvre baisse, certes, mais les
frais généraux montent sans cesse. Lors
d’un reengineering, on commence par déterminer ce qu’une entreprise doit
faire avant de dire comment elle doit le faire. Le
reengineering est une réinvention de l’entreprise, et non amélioration,
renforcement ou modification de celle-ci. Le reengineering signifie recommencer
à zéro. Il
faut engager un reengineering que s’il est nécessaire de frapper un grand
coup. 2.
Les effets du reengineering. 2.1.
La reconfiguration des processus opérationnels. Nous
avons conclu précédemment qu’il fallait organiser le travail autour de
processus opérationnels transversaux. Mais comment cela se manifeste-t-il concrètement ? Les
auteurs de ce livre ont observé et recensé les caractéristiques communes ou
thèmes récurrents des processus opérationnels reconfigurés dans des
organisations qui ont entrepris et réussi un reengineering. Les voici : • Plusieurs postes de travail sont regroupés en un
seul. Une
personne, le chargé de cas, est
responsable d’un processus de bout en bout. Par exemple, le
délégué du service clientèle peut renseigner le client sur le suivi de
sa commande. Si
la compétence d’une seule personne ne suffit pas pour prendre en charge le
processus entier, une équipe de cas
est mise en place. • Les décisions sont prises par les salariés. Au
lieu d’être séparée du travail effectif, la prise de décision est intégrée
au travail ; là où ils devaient consulter leurs responsables hiérarchiques
pour obtenir une réponse, les employés prennent maintenant les décisions
eux-mêmes. Le reengineering comprime donc également les processus
verticalement. • Les étapes du processus suivent un ordre naturel. La
succession linéaire des tâches impose un ordre de
priorité artificiel qui ralentit le travail. Avec le reengineering, le
travail s’ordonne selon l’ordre nécessaire de succession des tâches. Les
différentes étapes d’un processus peuvent ainsi se « chevaucher ». Par
exemple, dans le secteur automobile, habitacle et tableau de bord ne sont plus
conçus séparément. La
délinéarisation des processus les accélère de deux façons : 1)
beaucoup de travaux sont réalisés simultanément. 2)
la réduction du délai entre les premières étapes et les dernières,
diminue le risque qu’un changement important vienne rendre obsolète le
travail déjà accompli ou introduise une incohérence entre les travaux les
plus anciens et les plus récents. • Les processus ont des versions multiples. Avec
le reengineering, c’est la fin de la standardisation. Les processus
traditionnels à taille unique sont d’ordinaire assez complexes, puisqu’ils
doivent prévoir assez d’exceptions et de procédures spéciales pour traiter
les situations les plus diverses. Un
processus multiversion, au contraire, est net et simple, car chaque version
n’a besoin de traiter que les cas auxquels elle est destinée. Elle ne connaît
ni cas spéciaux ni exceptions. • Le travail est réalisé là où c’est le plus
logique. Le
client d’un processus doit accomplir tout ou partie de celui-ci afin d’éliminer
les passages de témoin et les frais généraux, donc de réduire les coûts.
Par exemple, il est inutile et coûteux pour un comptable de passer par le
service achats afin d’acheter une simple gomme ! • Les vérifications et contrôles sont réduits. Les
processus reconfigurés ne font appel aux contrôles que lorsqu’ils sont économiquement
justifiés. Au lieu de vérifier le travail au fur et à mesure de sa réalisation,
on y pratique le plus souvent des contrôles groupés ou différés. • Les pointages sont allégés. Comme
on diminue le nombre de points de contact du processus concerné avec l’extérieur,
on réduit le risque d’aboutir à des divergences entre les données obtenues
et donc de prévoir opérer des rapprochements. • Un gestionnaire de cas constitue un point de contact
unique. Le
gestionnaire de cas se comporte avec le client comme s’il accomplissait lui-même
la totalité du processus. Pour être capable de répondre aux questions des
clients et de résoudre leurs problèmes, le gestionnaire de cas doit pouvoir
accéder à tous les systèmes d’information utilisés par les personnes qui
assurent effectivement le processus, et pouvoir faire appel à elles ou leur
poser des questions en cas de besoin. • Un fonctionnement hybride, centralisé et décentralisé
prévaut. Les
technologies de l’information permettent de plus en plus aux entreprises de
fonctionner comme si leurs unités étaient pleinement autonomes, tout en
conservant les économie d’échelle liées à la centralisation. Dotés
d’ordinateurs portables reliés au siège par modem, les représentant peuvent
par exemple accéder immédiatement aux informations centrales. En même temps,
les contrôles inclus dans les logiciels qu’ils utilisent pour rédiger les
contrats de vente leur interdisent d’avancer des prix déraisonnables ou de spécifier
des délais de livraison que l’organisation ne pourrait respecter. 2.2.
Un nouveau monde du travail. Nous
venons de recenser un certain nombre de caractéristiques communes ou thèmes récurrents
des processus opérationnels reconfigurés. Mais entreprendre un reengineering
n’aboutit pas seulement à la transformation fondamentale des processus opérationnels.
Il a des conséquences pour bien d’autres parties et aspects de
l’entreprise. Qu’elles sont-elles ? • Les unités de travail évoluent - de services fonctionnels en équipes responsables d’un processus. Des
équipes responsables de processus - groupes de personnes travaillant ensemble
pour gérer un processus entier - s’imposent comme le moyen logique
d’organiser les personnes qui font le travail. Elles remplacent l’ancienne
organisation par services. En fait, il s’agit de rassembler à nouveau un
groupe d’employés artificiellement séparés au nom de l’organisation. Il
existe différentes sortes d’équipes de processus : 1)
L’équipe de cas : un certain nombre de personnes différentes
travaillent ensemble pour assurer un travail répétitif, tel que le traitement
d’une déclaration de sinistre. 2)
L’équipe virtuelle : des
personnes ne demeurent ensemble que le temps nécessaire pour accomplir une tâche
particulière et ponctuelle. Lorsque le projet s’achève, l’équipe se
dissout. 3)
L’équipe de cas ne comprenant qu’un seul membre, le
chargé de cas : une personne suffisamment formée assure la totalité
du processus. • Les postes de travail évoluent - de tâches simples à un travail multidimentionnel. Les
membres d’une équipe de processus partage une responsabilité collective
portant sur la réalisation du processus entier. Chacun a au moins une
connaissance de base de toutes les étapes du processus. Ils utilisent
quotidiennement une gamme de compétences plus large, mais ils doivent voir les
choses à plus grande échelle. • Les rôles évoluent - de postes contrôlés, vers des postes à responsabilité et autonomes. Les
responsables qui confèrent à des équipes la responsabilité de gérer un
processus entier doivent aussi leur déléguer le pouvoir de décision nécessaire
pour y parvenir. Les équipes de processus se gouvernent elles-mêmes. • La préparation à l’exercice d’un métier évolue - de la formation vers l’éducation. A
la formation du personnel, d’ordinaire appliquée, doit laisser la place à
l’éducation, ou l’embauche de gens éduqués. La
formation accroît l’habileté et la compétence du salarié et lui enseigne
le comment d’un travail. L’éducation
accroît sa perspicacité et lui enseigne le pourquoi. L’éducation continue,
tout au long de la vie professionnelle devient la norme. • Les critères essentiels de rémunération et de mesure des performances passent de l’activité aux résultats. La
rémunération dépend essentiellement de la contribution au résultat et de la
performance. Avec le reengineering, la
performance se mesure à la valeur créée, et la rémunération doit être
fixée en conséquence. Finis, la détermination des salaires d’après
l’ancienneté ou le rang hiérarchique, la rémunération calculée sur le
seul temps de présence, l’octroi d’augmentations au seul motif qu’une année
s’est écoulée... • Les critères d’avancement évoluent - de la performance à l’aptitude. La
récompense normale d’un travail bien fait est une prime et non un avancement.
L’avancement à un nouveau poste dans l’organisation dépend de
l’aptitude, non de la performance. C’est un changement, pas une récompense. • Les valeurs évoluent - du protectionnisme à l’ouverture. Le reengineering suppose que les salariés aient l’intime
conviction qu’ils travaillent pour leurs clients et non pour leur
entrepreneur. • Les managers évoluent - de superviseurs en animateurs. Les
équipes de processus n’ont pas besoin de patron, mais d’entraîneurs. Les
équipes sollicitent les conseils des entraîneurs, les entraîneurs aident les
équipes à résoudre les problèmes. Ils ne sont pas dans l’action, mais ils
en sont assez proches pour assister l’équipe dans son travail. Les
managers doivent renoncer à leur rôle de supervision pour faciliter, mettre en
condition, agir en hommes dont le travail est de développer les gens et leurs
compétences, de sorte que ces gens soient capables d’accomplir eux-mêmes des
processus créateurs de valeur ajoutée. • Les organigrammes évoluent - de hiérarchiques, à plats. Avec
le reengineering, le travail est organisé autour des processus et des équipes
qui les assurent. Si besoin est, les gens communiquent avec n’importe qui. Le
contrôle incombe aux personnes qui gèrent le processus. L’organigramme tend
donc à être plat, car le travail est réalisé par des équipes d’employé
égaux, jouissant d’une grande autonomie, et aidés par des managers peu
nombreux. • Les dirigeants évoluent - d’arbitres en leaders. La
bonne exécution du travail dépend des attitudes et des efforts d’employés
responsables : les dirigeants doivent donc agir en leaders, orientant et
renforçant par leurs paroles et par leurs actes les valeurs et les convictions
des salariés. Les
dirigeants font face à leurs responsabilités en s’assurant que les processus
sont conçus de telle sorte que les travailleurs puissent faire le travail nécessaire
et soient motivés par les systèmes de management de l’entreprise - les systèmes
de mesure des performances et de rémunération. 2.3.
Le rôle de levier des technologies de l’information. Dans
le reengineering de l’entreprise, les technologies de l’informations jouent
un rôle crucial : elles jouent un rôle de levier essentiel, car elles
permettent aux entreprises de reconfigurer leur mode de fonctionnement. Lorsqu’elles
considèrent les technologies de l’information, la plupart des entreprises
commettent une erreur fondamentale : elles la voient à travers le prisme
de leurs processus existants. « Comment utiliser ces nouvelles possibilités
technologiques pour renforcer, harmoniser ou améliorer ce que nous faisons déjà ? »
se demandent-elles. « Comment
utiliser les technologies pour parvenir à faire des choses que nous ne faisons
pas encore ? » devraient-elles plutôt se demander. Contrairement
à l’automatisation, le reengineering est affaire d’innovation. Voici
quelques exemples de technologies pouvant contribuer à un reengineering
efficace : Grâce
aux bases de données partagées, l’information n’est plus disponible
qu’à un seul endroit, mais simultanément partout où l’on en a besoin. Grâce
aux systèmes experts, un généraliste peut faire le travail d’un
expert. Grâce
aux réseaux de télécommunications, les entreprises peuvent bénéficier
simultanément des avantages de la centralisation et de ceux de la décentralisation. Grâce
aux outils d’aide à la décision, chacun peut prendre des décisions à son
niveau, sans remonter toute la ligne hiérarchique. Grâce
à la radio-transmission et aux ordinateurs portables,
le personnel de terrain peut expédier et recevoir des informations où qu’il
se trouve. Les
entreprises qui parviennent le mieux à détecter
et à exploiter le potentiel des nouvelles technologies bénéficieront
d’un avantage permanent et croissant sur leurs concurrents. Mais
attention, une technologie n’est plus nouvelle lorsque l’on peut
l’acheter. 3.
La mise en œuvre du reengineering. 3.1.
Les acteurs du reengineering. Ce
ne sont pas les entreprises qui reconfigurent les processus : ce sont les
hommes. Voyons dès à présent le choix et l’organisation des acteurs qui
mettent en œuvre le reengineering : • Le leader. Le
leader est le cadre dirigeant qui autorise et motive l’ensemble de l’effort
du reengineering. Le
rôle essentiel du leader est d’agir en visionnaire et de motiver le
personnel. Le
leader n’est pas quelqu’un qui fait faire aux autres ce qu’il veut mais
quelqu’un qui leur fait vouloir ce qu’il veut. Dans
cette optique, il doit adresser des signaux,
messages explicites concernant le reengineering, sa signification, ses raisons,
ses moyens, ses exigences. Prononcer des discours ne suffit pas à faire passer
le moindre message. Le
leader doit également produire des symboles,
actes accomplis pour renforcer le contenu des signaux, pour démontrer que ses
actes sont en accord avec ses paroles : muter les cadres qui s’opposent
au reengineering, affecter les meilleurs éléments de l’entreprise au
reengineering ... Le
leader doit aussi utiliser les systèmes pour renforcer les messages du
reengineering. Ces systèmes doivent mesurer et récompenser la performance des
gens de façon à les inciter à entreprendre un changement majeur. Les systèmes
de gestion doivent récompenser et non punir ceux qui échouent en testant de
bonnes idées. Dans
le reengineering, le rôle du leader est capital. • Le responsable du processus. Le
responsable du processus est le manager responsable d’un processus spécifique
et de l’effort de reengineering auquel il donne lieu. Son
travail n’est pas de réaliser le reengineering, mais de s’assurer qu’il
se réalise. Il doit former l’équipe de reengineering et faire en sorte qu’elle
puisse accomplir son travail. Il obtient les ressources dont elle a besoin, gère
les problèmes administratifs et s’efforce d’obtenir la coopération des
autres managers responsables de groupes fonctionnels impliqués dans le
processus. Le
responsable de processus est aussi celui qui motive, inspire et conseille son équipe. Plus
tard, c’est lui qui veillera à son bon fonctionnement. • L’équipe de reengineering. L’équipe
de reengineering est le groupe de personne qui se consacrent au reengineering
d’un processus particulier, qui établissent le diagnostic du processus
existant et qui développent son remodelage. Une
équipe comprend de 5 à 10 personnes, initiées
et néophytes, par processus. Les
initiés sont ceux qui travaillent déjà au sein du processus concerné. Ils
doivent connaître les ficelles du métier, mais pas au point
de croire que les vieux processus vont de soi. Leur atout le plus
important, leur crédibilité auprès de leurs collègues de travail. Mais,
pour changer vraiment, l’équipe doit aussi comprendre un élément
perturbateur, c’est le rôle des néophytes. Ne
travaillant pas dans le processus soumis au reengineering, les
néophytes apportent une plus grande objectivité et une perspective différente.
Leur travail au sein de l’équipe est de faire des vagues. Un
rapport de deux ou trois initiés pour un néophyte est convenable. Les
équipes de reengineering doivent être largement autodirigées.
Le principal critère de mesure et de récompense de leurs performances doit être
l’état d’avancement de leurs travaux. De plus, la réussite individuelle de
ses membres devrait être mesurée en grande partie d’après la performance de
l’équipe. Elles
n’ont pas de chef officiel, mais un meneur qui a pour rôle de permettre aux
membres du groupe de faire leur travail. Les
membres doivent au moins consacrer les trois quarts de leur temps à l’effort
de reengineering. Normalement
ils vivront eux-mêmes le résultat de leur travail. • Le comité de pilotage. Le
comité de pilotage est l’ensemble des cadres supérieurs qui mettent au point
la stratégie globale de reengineering de l’organisation et qui pilotent son
avancement. Facultatif,
il est présidé par le leader. Les
membres du comité se font exposer et résolvent les conflits entre responsables
de processus. Tout
à la fois cour d’appel, société de secours mutuel et parlement, le comité
de pilotage peut contribuer grandement à la réussite d’un programme de
reengineering à grande échelle. • Le capitaine de reengineering. Le
capitaine de reengineering est la personne responsable de la création des
techniques et outils de reengineering de l’entreprise, et garante des
synergies à assurer entre ses différents projets. Il
a deux fonctions principales : il aide et soutient tous les responsables de
processus et toutes les équipes du reengineering. Et il coordonne tous les
chantiers du reengineering en cours. Il
peut aider à choisir les membres des équipes de reengineering. Il
vérifie que les responsables de processus
restent sur la bonne voie tout au long du projet. Il
doit également anticiper et régler les problèmes d’infrastructure avant même
qu’ils ne se posent, tel l’informatique. Attention
à l’excès d’autoritarisme, le pouvoir doit demeurer entre les mains du leader
et du responsable du processus. Dans
l’idéal, la relation entre ces rôles est la suivante : le leader désigne un responsable du processus qui constitue une équipe
de reengineering chargée de traiter un processus avec l’assistance du
capitaine de reengineering sous les auspices du comité de pilotage. 3..2.
La sélection des processus à reconfigurer. Nous
venons de voir quels étaient les acteurs du reengineering. Maintenant voyons ce
dont ils s’occupent. Le
reengineering a pour objectif le remodelage des processus. Une
entreprise ne reconfigure pas sa direction des ventes ou son département de
production, elle reconfigure le travail accompli par les employés de ces
services. Les
processus sont ce que les entreprises font, par exemples : Le
développement de produit : du concept au prototype. Les
ventes : du prospect à la prise de commande. Le
service : de la demande à la solution. Les
entreprises peuvent cartographier leurs processus pour représenter les flux de
travail réalisé. Une fois la carte établie, quel sont les candidats au
reengineering, et dans quel ordre les traiter ? • Le choix des processus à reconfigurer. Le
choix des processus à reconfigurer s’opère
sur trois critères : dysfonctionnement,
impact et faisabilité. Les
processus qui posent le plus de problèmes sont prioritaires. L’importance
du processus, ou son impact sur le client extérieur, est le second critère à
considérer pour choisir les processus à reconfigurer dans une entreprise et
l’ordre dans lequel on avancera. Le
troisième critère, la faisabilité, dépend d’une série de facteurs qui déterminent
la probabilité de réussite d’une entreprise de reengineering. Plus il est
vaste et coûteux, plus la difficulté sera grande. • Comprendre les processus. Avant
de pouvoir commencer son travail de remodelage, l’équipe de reengineering
doit savoir un certain nombre de choses sur le processus existant : ce
qu’il fait, s’il marche bien ou mal et ce qui contribue le plus à déterminer
sa performance. Pour
comprendre un processus, l’équipe de reengineering commencera de préférence
par se mettre à la place des clients. Pour se renseigner sur ce que font les
clients il vaut mieux les regarder le faire ou, mieux encore, le faire soi-même. L’étape
suivante consiste à se représenter ce que le processus fournit actuellement -
à comprendre le processus actuel lui-même, le quoi et le pourquoi de ce
processus. Plus les membres de l’équipe maîtriseront les véritables
objectifs du processus, mieux ils réussiront son remodelage. 3.3.
Le remodelage des processus. Après
avoir identifié les processus à remodeler, se pose la question de la manière
de l’effectuer : • Lors d’une première réunion, la session de
remodelage ou « redesign » ,
l’équipe de reengineering fait jaillir de grandes idées selon trois
techniques possibles : Appliquer
avec audace un ou plusieurs principes du reengineering :
il faut essayer de pousser à l’extrême le principe selon lequel il vaut
mieux organiser le travail en fonction de son résultat plutôt qu’en fonction
des tâches (ou le principe selon lequel le nombre de personnes qui
contribuent au fonctionnement d’un processus doit être aussi faible que
possible). Rechercher
et détruire les idées reçues : par exemple il faut détruire l’idée reçue
suivante : si une entreprise possède des centres de distribution régionaux,
c’est probablement qu’elle pense que les centres régionaux assurent un
meilleur service qu’une distribution centralisée. S’efforcer
d’utiliser les technologies dans un esprit créatif :
voyez le potentiel des nouvelles technologies, puis déterminez si cela vous
aide à repenser les processus. • Voici huit leçons tirées des expériences. 1.
il n’est pas nécessaire d’être un expert pour remodeler un
processus. 2.
être un néophyte est un atout. 3.
il faut se défaire des idées reçues. 4.
il est important de voir les choses du point de vue des clients. 5.
le reengineering est de préférence un travail d’équipe. 6.
il n’est pas nécessaire d’en savoir beaucoup sur les processus
actuels. 7.
il n’est pas difficile d’avoir de grandes idées. 8.
le reengineering n’est pas forcément quelque chose de pénible. 3.4.
Les messages pour motiver au reengineering. Demeure
le défi énorme qui consiste à convaincre l’ensemble des salariés de la nécessité
du reengineering. Deux messages sont à faire passer : « voilà où
en est aujourd’hui notre entreprise et pourquoi elle ne peut en rester là »
et « voilà ce qu’il nous faut devenir en tant qu’entreprise ». Pour
exprimer et faire connaître ces messages essentiels, les entreprises utilisent
deux documents : « l’appel à l’action » et « la définition
de la vision ». • L’appel à l’action
doit comprendre le contexte professionnel, le problème opérationnel, les
demandes du marché, le diagnostic et enfin le prix ou plutôt le coût de
l’inaction. •
Une vision forte contient trois éléments : elle se concentre
sur le métier de l’entreprise, elle comprend des objectifs mesurables et des
instruments de mesure, enfin, elle est vraiment puissante, elle transforme les
bases de la concurrence dans le secteur. Par exemple, l’entreprise Federal
Express des Etats-Unis a créé la vision suivante : « Nous livrerons
des colis le lendemain avant 10h30 ». Conclusion : les causes d’échec du reengineering ne doivent pas constituer un frein au changement. Réussir
un reengineering est difficile. Voici les causes d’échec du reengineering,
les plus habituelles : Tenter
d’améliorer un processus au lieu de le changer, ne pas se concentrer sur les
processus opérationnels, s’intéresser uniquement au remodelage des processus
(en fait il faut « refaire » la société), négliger les
valeurs et les convictions des individus, accepter un compromis sur des résultats
mineurs, abandonner trop vite, fixer des limites à priori à la définition du
problème et à l’envergure du reengineering (le reengineering débute en
effet par la définition des objectifs à atteindre et non de la façon
d’atteindre ces objectifs), laisser la culture d’entreprise et les attitudes
des dirigeants empêcher le démarrage du reengineering, essayer de le déclencher
à partir de la base (l’ampleur de vue nécessaire au reengineering manque aux
gens proches de la base et tout processus opérationnel traverse inévitablement
les frontières organisationnelles, de sorte qu’aucun cadre moyen n’aura
assez d’autorité pour en réclamer la modification), désigner pour conduire
le reengineering quelqu’un qui ne le comprend pas, rechigner sur les
ressources dévolues au reengineering, le noyer dans un trop plein
d’initiatives (les entreprises qui se refusent à placer le reengineering au
sommet de leurs préoccupations feraient mieux d’y renoncer totalement),
dissiper l’énergie de l’entreprise sur une multitude de projets de
reengineering, tenter un reengineering alors que le PDG est à deux doigts de la
retraite, être incapable de faire la différence entre le reengineering et les
autres programmes d’amélioration, s’attacher exclusivement aux concepts (il
faut dépasser la phase de l’idée), tenter un reengineering sans déplaire à
quiconque, battre en retraite face aux résistances soulevées par le
reengineering, faire traîner l’effort en longueur (un an au plus). En
dépit des risques d’échec, les auteurs de ce livre, Michael Hammer et James
Champy, demeurent encouragés par
le nombre de succès du reengineering. Ils prennent ainsi comme exemples les
entreprises américaines Hallmark (cartes de voeux ...), Taco Bell (fast-food),
DRG (vente d’assurances par marketing direct) et Bell Atlantic (télécommunications),
entreprises qui ont réussi leur reengineering. Nous
vous conseillons de découvrir leurs histoires dans les derniers chapitres de
leur ouvrage. Elles illustrent parfaitement l’idée qu’il faut remettre en
cause le fonctionnement de l’entreprise traditionnelle. En
la reconfigurant transversalement, le reengineering permet en effet de réaliser
d’importants gains sur les coûts, les délais, le service et la qualité, et
lui développe ainsi un nouvel avantage concurrentiel. Cet
ouvrage nous en apporte la preuve ; demeure le plus difficile, le mettre en
œuvre ! |